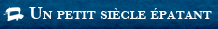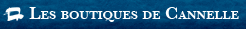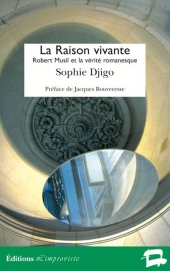La Raison vivante
Robert Musil et la vérité romanesque
Préface de Jacques Bouveresse
Sophie Djigo
Les pensées qui proviennent de notre raison sont des pensées vivantes, qui nous « parlent » et nous sollicitent. La raison, tout comme les idées morales, a donc un pouvoir expressif pratique, contrairement à l’inertie qu’on lui reproche souvent. Robert Musil dans ses œuvres littéraires fait jouer cette raison vivante qui s'adresse à l'intellect autant qu'à la volonté, et offre la possibilité d'une connaissance littéraire dynamique et active.
4ème de couverture
La raison est-elle incapable de nous faire agir ? Lui faut-il nécessairement le secours de quelque désir ou passion afin de nous émouvoir, et en dernière instance, de nous mouvoir ? C’est ce reproche bien connu, qui discrédite les pouvoirs de la raison sous prétexte de son inertie, que ce livre entreprend de discuter et de contester.
Aux antipodes de la vision caricaturale d’une rationalité aride et abstraite, privée d’efficacité pratique, l’auteure puise dans la pensée et les œuvres de Robert Musil, les éléments d’une raison vivante et expressive, qui s’adresse à l’intellect autant qu’à la volonté. Les pensées qui proviennent de la raison ne sont pas mortes et nous n’y sommes pas insensibles ; ce sont des pensées vivantes, qui nous « parlent » et nous sollicitent. En examinant les pouvoirs expressifs de la raison, ce livre aborde les questions de la nature de la rationalité pratique, du pouvoir des idées morales et de la possibilité d’une connaissance littéraire.
Sophie Djigo est agrégée et docteur en philosophie Ses travaux portent sur la rationalité pratique, l’éthique littéraire et la philosophie morale.
Jacques Bouveresse Préface
Introduction
PARTIE I – RAISON ET EXPRESSIVITÉ
Chapitre 1. Les arguments et la raison morale
- Les arguments moraux
- Rien que des arguments ?
Chapitre 2. Prendre au mot les idées
- L’argumentation en littérature : le « test » de la fiction
- L’esprit de l’ironie : littéralité et exigence de sens
Chapitre 3. Théorie de l’expression
- Vérité et connaissance romanesques
- L’expression des émotions
- L’expressivité morale
PARTIE II – LECTURE ET CONVICTION
Chapitre 1. Langage et psychologie
- L’expérience vécue de la signification
- Éprouver et dire
- Le problème de la réception
- Liittérature et sentimentalisme
Chapitre 2. La participation, le ton, la voix
- Comprendre le ton / Avoir l’oreille
- Pensées mortes et pensées vivantes
PARTIE III – LE LABORATOIRE MORAL DU ROMAN
Chapitre 1. Vivre la vie comme un roman
Chapitre 2. L’esthétique est-elle une éthique ?
- Le double rejet de l’esthétisme et du moralisme
- La tâche morale de l’écrivain et les solutions partielles
- La lecture éthique des œuvres : Musil et Tolstoï
- Le « côté religieux » de l’éthique
Chapitre 3. Le « laboratoire moral » du roman
- L’expérimentation en littérature
- Les suppositions et l’irréel
Chapitre 4. La satire de l’idéalisme et l’imagination utopique
- Les idéaux sans l’idéalisme
- Les utopies dans le roman
Conclusion
Bibliographie
Index des noms